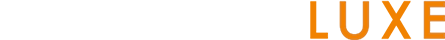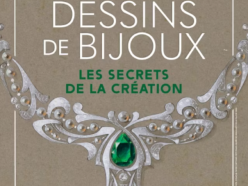|
|

|
|
Ni les joailliers ni les stylistes n’ont hésité à s’inspirer de l’art de leur époque. Au début du XXe siècle, la révélation des Ballets russes de Serge Diaghilev influence la mode. Cartier monte pour la première fois ensemble des saphirs et des émeraudes après avoir vu les décors bleu et vert créés par Léon Bakst pour le ballet Schéhérazade (1910). En 1923, Mademoiselle Chanel crée des vêtements « russes », telle sa roubachka portée sur une jupe longue. Des années plus tard, Hubert de Givenchy rend hommage à Rothko, Braque ou Matisse à travers ses collections de haute couture, tandis que Saint-Laurent entre dans l’histoire de la mode grâce à ses robes inspirées de Mondrian. Aujourd’hui, c’est Louis Vuitton qui réalise des sacs en collaboration avec les artistes Takashi Murakami ou Jeff Koons. De tels allers-retours entre art et mode ne sont guère surprenants.
Plus surprenante est la manière dont les stylistes des grandes maisons, qui créent des vêtements pour les élites économiques mondiales, s’inspirent de la contre-culture. On devrait dire la récupèrent, celle-ci se définissant par nature « contre » la culture dominante. On se souvient, en 2000, de la douteuse collection de John Galliano inspirée par les vêtements des SDF… Ces dernières années, suivant en cela les expérimentations de Jean-Paul Gaultier, c’est l’esthétique sado-masochiste que l’on retrouve ici ou là sur les podiums : par exemple les créations de Jeremy Scott pour Moschino. Ici, le dialogue est plus fécond, car si l’univers BDSM reste largement ignoré du commun, il n’en est pas moins riche d’une longue histoire littéraire, picturale, photographique et cinématographique.

Surtout, les codes du SM consonent avec un principe fondateur de l’élégance : l’idée de « tenue ». Le terme ne désigne pas seulement un assortiment de vêtements, il ouvre vers une éthique. « Avoir de la tenue », c’est ne jamais se résigner aux affaissements de la fatigue ou de l’âge, c’est résister, grâce à l’usage des artifices, à la tentation du laisser-aller. Dans un passage saisissant du Siècle des ténèbres, Jack-Alain Léger évoque Michel Leiris et Francis Bacon dans un bar parisien ; ils sont très vieux, leurs corps font un peu sécession, mais tous deux portent costume ajusté, cravate serrée et épingle de col. Cette épingle fascine l’écrivain, comme si elle était, dans le léger inconfort qu’elle provoque, l’ultime digue contre l’effondrement. Il y a aussi beaucoup d’épingles dans les rituels SM, et beaucoup d’autres objets pointus, abrasifs ou contraignants, comme ces corsets que met volontiers en scène Jean-Paul Gaultier. Avec eux le corps est paré et mis à l’épreuve, en même temps rigidifié, comme un papillon épinglé sous verre – tant il est vrai que, si l’underground sexuel est un espace de pulsions, c’est d’abord de pulsion scopique qu’il s’agit. Bon nombre de défilés de mode, aujourd’hui, à des années-lumière des traversées de salons des années 1950, ne ressemblent-ils pas à des envols de papillons de nuit aux ailes bridées ?
Les pratiques SM, à la différence des sexualités hédonistes, ne mettent pas en valeur une nudité joyeuse. Les objets du désir paraissent vêtus (à demi vêtus !) de costumes divers, de combinaisons, de bottes… Par là sont exaltées des matières, si étroitement associées au plaisir qu’elles entrent dans le registre du fétichisme : le latex et le cuir au premier chef. La peau n’est pas dissociée de ce qui la couvre et du même mouvement la dénude. Aucun retour à la nature, à sa sauvagerie primitive, dans les rassemblements d’adeptes. Au contraire, on peinerait à trouver assomptions du culturel plus explicites… Le même fétichisme prévaut chez les couturiers, légèrement transposé sans doute, mais sensible dans le seul énoncé des textiles rares dans lesquels sont coupés les vêtements. Et le geste audacieux du créateur, introduisant de la dissymétrie, échancrant avec insolence, mariant les textures, est d’autant plus admiré qu’il s’exerce sur des matières plus précieuses, tout comme on froisse ou déchire une étoffe dans l’impatience d’un corps.

En un mot, mode et jeux pervers partagent une extrême sophistication, le refus d’une beauté « naturelle », le recours à l’artifice comme instrument de séduction et adjuvant du désir. Autant dire que l’une et les autres font un large appel à l’imagination. Les œuvres des très grands sont d’abord des occasions de rêverie, comme Proust l’a suggéré admirablement à propos des robes de Fortuny. Mais la rêverie d’une amatrice ou d’un amateur de haute couture demeure incomparablement plus sage que la rêverie érotique d’une amante ou d’un amant appréciant des goûts plus forts que celui de la « vanille » de la libido conjugale. La similitude trouve ici ses limites. L’industrie du luxe peut sans doute tout récupérer, mais le désir transgressif campe souvent au-delà des limites du récupérable, dans un no man’s land où même les plus provocateurs des directeurs artistiques ne peuvent se permettre d’aller. Il faut s’en réjouir, puisque c’est un espace de liberté que dessinent ainsi les lignes de fuite passionnelles, un espace où la théâtralisation des apparences de la marchandisation suscite la plus efficace des résistances à la marchandisation générale du social.