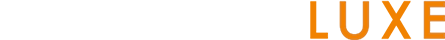|
|

|
|
Paul Ardenne, professeur, commissaire d’expositions et essayiste, est l’un des plus réputés parmi les théoriciens de l’art contemporain ; sa bibliographie sur le sujet est impressionnante. C’est peu dire qu’on ne l’attendait pas dans le rôle du glossateur des sports mécaniques, a fortiori du moins populaire d’entre eux, à savoir les courses de dragster…
Guillaume de Sardes : Le dragster c’est « la distance parcourue en un éclair » au prix le plus élevé, tout comme le Concorde, bijou technologique, dont la forte consommation de carburant rendait l’exploitation déficitaire.
Paul Ardenne : En effet. Le dragster coûte cher, comme tout ce qui est extrême ou peu s’en faut, à l’exception peut-être du saut à l’élastique. La mécanique du dragster est une mécanique de pointe, toujours exploitée à la limite de la casse, de la fracture. Pour information, un tiers de ces machines d’accélération, dans les catégories supérieures, les Top Fuel (ceux-ci passent de 0 à 500 km/h en 300 mètres et en 4 secondes…), cassent sur la ligne de départ ou dans les premiers mètres. La technologie est à son comble. Un Top Fuel à moteur thermique, c’est 12 000 cv, soit cent fois la puissance d’une automobile moyenne. Cette excellence technique a son coût d’exploitation, forcément. Hyperbolique. Hors normes.

GS : Le luxe est soumis à son propre dépassement, tout comme les records de vitesse sont sans cesse battus. Luxe et dragsters semblent se retrouver dans la « quête d’un inaccessible absolu ».
PA : Oui, à ceci près que le luxe est infiniment plus malléable que le dragster. Le luxe du dragster, c’est de battre le record de Samuel Miller, établi dans les années 1980 avec une machine équipée d’un moteur de fusée Apollo de 30.000 cv. De 0 à plus de 600 km/h sur 400 mètres départ arrêté et en 3 secondes et demie. Tout le reste, au fond, est littérature. Le principe d’acmé, plus que celui de l’hubris, le principe du maximum plus que celui du désordre maximaliste, est implicite au dragster. Ce n’est pas le cas s’agissant du luxe. Si la ferveur de la masse va au vêtement surchargé, par exemple, le luxe sera de porter du Miyaké ou du Yamamoto, des étoffes sobres radicalement en rupture avec l’aspiration commune. La rareté du dragster renvoie au record à battre et à rien d’autre. Elle ne connaît pas de variation. Le luxe est toujours contextuel, le dragster n’est que conjoncturel, avec des bases culturelles établies et gravées dans le marbre.
GS : Les Top Fuel se distinguent (entre autres) des véhicules communs par l’usage qu’ils nécessitent de carburants spéciaux (méthanol, nitrométhane, peroxyde d’oxygène, etc.) tout comme le luxe recourt à des matériaux inhabituels (peau de crocodile, de python ou platine…).
PA : En effet. Mais je crains que le rapprochement ne s’arrête là. L’univers matériel du dragster, au fond, est simple : la quête du matériau le plus efficace, qu’il s’agisse de celui des queues de soupapes, du pouvoir de calcul du débimètre d’alimentation ou de la qualité de grip des pneumatiques. Le répertoire matériel du luxe est infiniment plus large. Le luxe peut aimer les matériaux rares mais aussi, par esprit de contradiction ou parce que cela devient tendance, des matériaux très banals. Prenons le cas des meubles en bois de liège, très coûteux. Ceux-ci, au départ, sont conçus dans la sphère de l’art contemporain, réglé par le principe d’unicité de l’œuvre d’art. Une fois démocratisé ce type de meubles, l’esprit de luxe, dans le domaine du mobilier, sera passé à autre chose, à un autre matériau. Le luxe est par définition une dérive. Dérive à partir du goût commun, qu’il considère comme méprisable ; dérive à partir de toute normalisation, qui fédère, là où le luxe ne reconnaît que ce qui est divisé et minoritaire. Le terme « Luxe » vient de lumière, lux, en latin. Mais une lumière toujours réorientée, de type spot et non pas néon. Le luxe désigne, détermine et délimite, comme le spot, qui n’éclaire qu’un point de l’espace. Le vulgus, le « banal », étymologiquement « ce qui appartient au plus grand nombre », irradie largement, comme le néon. Rien de commun, pas de partage du territoire sauf accidentel, et jamais durable.
GS : Vous insistez sur l’aspect monstrueux (au sens étymologique du mot, le monstrum étant ce qui sort de la norme) du dragster. Le parallèle paraît évident avec la haute couture, notamment avec des créations comme celles d’Alexander McQueen.

PA : Là encore je crains de vous décevoir. Le dragster ne souffre pas l’exubérance. Sa religion est l’efficacité absolue, l’efficiency, terme anglo-saxon que l’on peut traduire par le mot « rendement », particulièrement approprié. Ou cela marche à fond, ou c’est de la merde, si vous me passez l’expression. Le dragster n’est monstrueux que si on l’aborde d’un point de vue mythologique, à la Roland Barthes, en spectateur qui n’attend que d’être ébaubi par ce qu’il voit et qui met du mythe dans tout ce qu’il voit, même un cageot, à la Francis Ponge (mais pourquoi pas ?). Mais en réalité, le dragster est juste une machine musclée et intelligente, bien conçue pour ce qui est sa tâche, une tâche unique et obstinée, et qu’un pilote doit servir. L’équivalent d’un char d’assaut ou d’une moissonneuse-batteuse dans leurs domaines respectifs. Vous parlez des créations du regretté Alexander McQueen, si riches en profusion, si denses d’inattendu, d’ouverture à l’imaginaire, d’absurdité parfois (souvent !). Je me souviens comment la chanteuse pop Lady Gaga, avant la mort de ce styliste, portait démonstrativement ses chaussures McQueen dans ses clips délirants : on ne voyait qu’elles, ces chaussures, et en les voyant si différentes de nos chaussures ordinaires, on voyait Lady Gaga jouant à être extraordinaire. Un parfait alliage. Cette dimension d’exagération ou de pas de côté n’a rien à voir avec le dragster, un univers qui ignore la légèreté, la frivolité ou le dandysme.

GS : Vous définissez le dragster comme une « machine plus », c’est-à-dire dont l’excès fait partie intégrante. Cette démesure n’est-elle pas aussi le propre du luxe ?
PA : J’ai répondu d’une certaine manière à cette question, déjà. Le luxe n’a pas toujours partie liée avec la démesure. Il est plutôt une forme de contre-mesure. Ce qui est la mesure de tous, de la collectivité-masse, ne saurait être luxueux. Même si le luxe, soit dit en passant, s’est fortement démocratisé. Le moindre appartement de base en banlieue, aujourd’hui, est plus luxueux qu’une chambre de courtisan à Versailles au XVIIe siècle. Vous y trouvez la lumière électrique, l’isolation thermique, l’eau courante, des toilettes, un système de communication sophistiqué, autant de miroirs que vous voulez, de quoi vous coiffer comme au salon de coiffure et de cuisiner comme au restaurant, etc. Si l’on comprend le luxe comme l’accès au maximum, alors oui, le dragster appartient à l’univers du luxe. Mais dans ce cas seulement.
GS : Le dragster est une activité « hors limites, hors sagesse, hors raison » qui s’oppose, comme le luxe s’y oppose, à la slow life, à un monde en décroissance, à cette vision qui voudrait que l’histoire reparte à l’envers.
PA : Là est le point le plus important du dragster, le point « civilisationnel », si vous voulez. Et la raison pour laquelle, en tant qu’intellectuel « spécifique » et grand amateur des sports mécaniques, j’ai souhaité tirer le dragster du quasi néant civilisationnel auquel on le cantonne. Ne voir dans le dragster qu’un certain type de compétition où l’on ne veut au fond qu’accélérer toujours plus vite est réduire ce sport à sa dimension athlétique, en oubliant ce qu’il a de culturel. On s’en rend bien compte à présent, tandis que le problème principal de nos vies est de « coller » au monde, à ses mutations permanentes, souvent plus rapides que notre capacité de réaction, un monde postmoderne de surcroît assujetti à l’empire de l’opinion, de la culture mouvante, du point de vue sans cesse requalifié et modifié que l’on forme tant bien que mal sur l’ordre des choses (qui donne l’impression, du coup, de devenir un désordre des choses). Une des grandes réponses de la civilisation est, en effet, la décroissance, la décélération : il faut prendre plus de temps, ralentir, célébrer la lenteur comme a pu le faire, avec un talent certain mais limité, ce beau sociologue de la jouissance sensible qu’était Pierre Sansot, un épicurien très respectable. Cette tentative de ralentissement n’est pas méprisable, tant s’en faut. Son problème, toutefois, est d’être une réaction faible, la réaction de celle ou celui qui a renoncé à vouloir suivre l’ordre pulsatif du réel. Le dragster parle d’un monde rapide, celui des cellules de nos corps qui se démultiplient à vitesse grand V, il tient pour enfantin le choix d’un rapport au monde où l’on s’effondre dans un pré en croyant que l’on va jouir de la vision de la croissance d’un brin d’herbe. Tandis que les galaxies, au-dessus de nos têtes, tournent à des vitesses folles, et que la lumière circule à 300 000 km/sec. La nature est, au regard des critères humains, rapide, c’est ainsi. La rapidité n’est pas haïssable.

GS : « Nous recherchons l’utilité des gestes, des actes, des situations, du matériel ? Le dragster n’a pas d’utilité tangible, il n’est pas useful. » Pas plus que ne l’est une bague du génial orfèvre vénitien Codognato.
PA : Oui, le dragster, disons, n’est pas « comptable », il n’est pas économe. Et la mission qu’il sert à tout prix, y compris le prix récurrent qu’est la mort de ses servants sur la piste, les pilotes (il s’agit-là, officiellement, du sport le plus « tueur » du monde, à l’origine d’une véritable hécatombe aujourd’hui encore, en dépit des mesures de sécurité draconiennes mises en place sur les dragstrips, les lieux de la compétition), cette mission, donc, n’a rien à faire avec la pingrerie. Le dragster exige que toute la force de libération mécanique dont sont capables les êtres humains soit libérée à chaque run, pour chaque accélération. Telle est sa gloire, et tant pis si cela coûte cher. Côtoyer l’absolu a un prix. Élevé, en général, si l’on fait exception de l’orgasme sexuel, qui peut nous être donné pour peu.
Paul Ardenne, Apologie du dragster, l’espace-temps intense, Le Bord de l’eau, 2019, 20 €.
Photographies par Ali Kazma