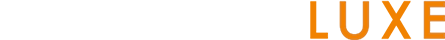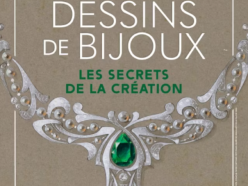|
|

|
|
Peter Lindbergh était le portraitiste préféré des supermodels des années 90. L’homme qui a immortalisé les Kate Moss, Christy Turlington, Cindy Crawford et autre Naomi Campbell à l’orée et au sommet de leur gloire. Le plus parisien des photographes allemands est mort mardi 3 septembre à l’âge de 74 ans.
La mode vient de perdre l’un de ses plus prestigieux ambassadeurs. Mort dans son sommeil à Dallas alors qu’il était en partance pour Ibiza, Peter Lindbergh s’est éteint entre deux avions, plus que jamais citoyen d’un monde qu’il aura parcouru inlassablement pour y mettre en scène les plus belles femmes de son temps. Toujours ancré dans son époque, il venait de réaliser pour le Vogue britannique les portraits de Greta Thunberg, Jane Fonda et de la première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern, entre autres « Faces for change ».

Quand on pense à Peter Lindbergh, on pense à ses clairs-obscurs somptueux. On pense à cet art de magnifier la beauté dans la rouille des friches industrielles. On pense à cette mythique couverture de Vogue de 1988 sur laquelle les futures impératrices des podiums posent en chemise blanche pour homme et en petite culotte sur la plage de Santa Monica. Comme une bande de copines s’autorisant une dernière balade incognito avant le hold up planétaire. La photo est tellement spontanée, tellement en dehors des codes, que ses commanditaires l’oublient dans un tiroir avant qu’Ana Wintour n’en fasse l’une des photos les plus iconiques de son temps.
Enfant du baby-boom, Lindbergh naît en 1944 dans la Pologne occupée, avant de passer son enfance dans la Ruhr. A ses yeux « le lieu le plus moche du monde », mais où réside probablement la clé de son oeuvre. « C’est la stricte construction humaine, disait-il en 2014, la représentation même du travail, les mines, le gris des usines géantes, l’uniformité du paysage industriel. Plus je vieillis, plus je réalise que ma vision de la beauté, c’est exactement ça : la Ruhr ».
Au début des années 60, cet homme du Nord s’évade pour Arles et la lumière de la Méditerranée, avant de s’installer à Düsseldorf, capitale de l’art conceptuel, où il travaille auprès d’un photographe commercial dénué d’ambition. Bientôt, il ouvre son propre atelier et collabore avec le journal Stern. Puis ce sera Paris en 1978, début d’une relation privilégiée avec l’univers de la beauté sur papier.
Ambassadeur de la beauté au naturel
En plein triomphe du kitsch, du bling-bling et de l’argent facile, Lindbergh impose sa vision très vieille Europe de la photo de mode : austère, froide et minimaliste. Comme si quelqu’un avait confié un appareil photo à un pasteur luthérien dans une fête de traders remplie de femmes somptueuses. Les stylistes et rédactrices de mode adorent. A la suite de son explosion dans les années 1990, il fait partie du « Big Four » de la photo de mode, aux côtés de Richard Avedon, Irving Penn et Helmut Newton.
La clé de sa réussite d’après Libération ? Avoir « réussi à faire croire qu’il suffisait d’être naturelle pour être belle ». Il avait la réputation de préférer les modèles aux vêtements qu’elles portaient. Il considérait le maquillage comme une forme de mensonge et refusait de gommer les imperfections sur ses clichés. Un souci du naturel et la vérité qui lui vaut aujourd’hui d’être qualifié par le Monde de « photographe des femmes en liberté ». Ces dernières années, il s’était montré plutôt sévère avec l’industrie (trop de défilés, trop d’événements, trop de marques), allant jusqu’à comparer la photo de mode à une vache : « elle mange un truc, avale, régurgite et puis remâche la même chose et recommence ».
Quand on lui demandait d’où lui venait son attrait pour le noir et blanc, ce prince du glamour amateur de sculpture et de méditation transcendantale avait cette réponse d’un anti-bling absolu, une justification populiste au sens noble du terme : « J’ai réalisé que j’avais grandi avec tous ces photographes américains, comme Dorothea Lange, qui voyageaient à travers les États-Unis à la demande du Congrès, pour photographier la vie du peuple. Leurs images, qui étaient en noir et blanc, étaient très liées à l’idée de vérité, de réalité. Je crois que c’est ce qui m’a fasciné inconsciemment quand j’ai utilisé le noir et blanc : on n’essaie pas de faire plus joli, ou de faire chic, ou de faire agréable, non, c’est véridique. »