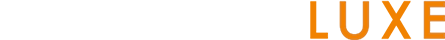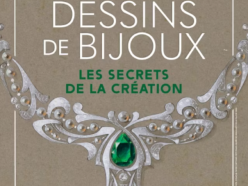|
|

|
|
En dépit de son apparente évidence, la notion de luxe est difficile à penser.
Dans la République Platon distingue le nécessaire et le superflu. La recherche du seul nécessaire est vertueuse. Au contraire, la recherche du superflu est funeste : les hommes, obsédés par la possession de produits étrangers, se lancent dans l’expansion territoriale, c’est-à-dire dans la guerre. L’idée se retrouve grosso modo à la génération suivante chez Épicure. Tous les désirs ne doivent pas être satisfaits, non tant parce que leur satisfaction serait impossible ou trop complexe, mais parce qu’il est bon de s’imposer à soi-même des limites. L’idée de tempérance entre alors dans le catalogue des vertus les plus précieuses. Les théoriciens latins du stoïcisme insistent également dans ce sens. La statue de soi qu’ils entraînent à sculpter, mettant en valeur la dignité et la gravité du sujet, exige le retrait plus que l’accumulation. La leçon des Anciens, de ce point de vue, est que la mesure des besoins répond avant tout à des critères moraux.
Cette leçon est bien oubliée. Le critère moral des besoins s’est effacé devant celui de la valorisation économique. Nos sociétés contemporaines sont régies par un modèle consumériste. Il existe d’innombrables produits superfétatoires. L’élargissement des besoins ordinaires repousse sans cesse la frontière du luxe. C’est pourquoi l’objet de luxe ne conserve pas longtemps son caractère exceptionnel : il finit toujours par rencontrer son propre déclassement. Ce phénomène est accéléré par l’uniformisation des conduites et la revendication égalitaire. L’objet « de luxe » (comme le téléphone portable) devient vite une marchandise ordinaire, puis quasiment de première nécessité. La définition du luxe comme ce qui excède les besoins devient alors mouvante, si ce n’est impossible. Ce d’autant que, symétriquement, le caractère accessoire d’une part importante des biens de consommation courante les élève au rang des choses superflues. Cette extension du périmètre des superfluités trouble les catégories anciennes.
La définition du luxe serait donc à chercher ailleurs : dans sa fonction symbolique d’exaltation de l’unicité du possesseur par la rareté de l’objet possédé – comme dans les vieux trésors d’églises où les reliques des saints voisinaient avec des cornes de licorne et des œufs d’autruche. Mais est-ce bien encore l’objet dit de luxe qui remplit cette fonction ? Y a-t-il quoi que ce soit de singularisant à porter au poignet une montre de grande marque, à se vêtir d’un costume sur mesure, à chausser des souliers de bottier ? Le discours que producteurs et médias spécialisés tiennent en continu suffit à persuader que ce ne sont là que pièces d’uniforme pour individus de médiocre envergure, prompts à exhiber les signes conventionnels de ce qu’ils analysent comme leur « réussite ».
L’absolument singulier, aujourd’hui, n’est certes plus à chercher du côté de la production « de marques », mais du côté du monde de l’art. Suivre le travail d’un peintre, d’un photographe, d’un plasticien, s’arrêter à une œuvre qui séduit, lui donner place dans son intérieur (sur ses murs, mais aussi dans ses pensées), voilà qui en dit plus long sur la subtilité d’un regard que le choix d’un vêtement ou d’un parfum – sauf à jouer jusqu’à l’extrême la carte de l’accumulation, fourreau de lamé et pantoufles de vair, mais tout le monde ne rêve pas de ressembler à Madonna ou à Liberace. Le vrai luxe redevient ainsi ce qu’il était dans la sagesse antique : un ethos. Irréductible à tous les discours commerciaux, étranger à l’exhibition, il prend son sens et son essor dans la solitude du studiolo, comme autrefois chez les princes humanistes d’Urbino ou Florence.
Le luxe qui se vend avenue Montaigne, de son côté, n’est peut-être plus qu’une construction publicitaire. Serait luxe ce qui est présenté comme tel : argument d’autorité, le plus pauvre de tous. Mais argument souvent efficace. C’est sans doute pourquoi la notion de luxe, si difficile à penser, paraît si évidente.